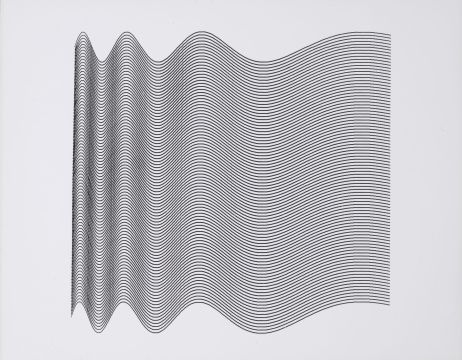Au Musée du Pavillon Vendôme, à Aix-en-Provence, l’artiste Yosra Mojtahedi présente jusqu’au 14 janvier ses « machines-humaines » et ses « corps-fontaines » : un ensemble de sculptures interactives, mélancoliques et sensorielles. Portrait, en quelques chimères et mots-valises, d’une artiste dont l’œuvre fait coexister mythologie persane, éco-féminisme et nouvelles technologies.
Yosra Mojtahedi est née à Téhéran en 1986, sept ans après la révolution islamique qui renverse la monarchie du chah Pahlavi au profit de la République islamique d’Iran. Sa mère est perse, son père kurde, issu d’une famille d’imams et de soufis ayant joué un rôle notable dans la vie du Kurdistan iranien et au sein de laquelle la poésie, la littérature et la musique occupent une place importante. « Quand j’étais enfant, nous habitions une petite maison sur la rue Bahar, se souvient-elle. La ville était aride, mais mon père avait la main verte : nous avions ce jardin, sauvage et luxuriant, qui poussait librement au milieu de la ville ».
Yosra Mojtahedi commence à peindre adolescente, dans un petit atelier aménagé par sa famille dans le garage. La peinture lui permet alors d’explorer ce que la religion et le régime politique interdit : la question du désir (d’où sa présence au sein de la dernière édition de la Biennale Chroniques, centrée autour de cette notion), de la relation entre les sexes, ainsi que ses interrogations à propos du divin : « Le mot “Dieu”, vaste et masculin, me trouble depuis que je suis petite. À l’école, il rôdait en permanence cette question essentielle sur celui qui a insufflé la vie en tout. À l’époque, ce n’était pas des questions que je pouvais poser, et encore moins résoudre : le risque de transgression, de franchissement de la ligne et fatalement, de sacrilège, arrivait toujours très rapidement. Arrivée en France, j’ai pu reposer ces questions, mais en d’autres termes. »

La majeure partie des thèmes aujourd’hui caractéristiques de son œuvre proviennent de cette jeunesse iranienne : le refus de toute classification définitive, son goût pour la littérature existentialiste de Jean-Paul Sartre et de Sadegh Hedayat, sa passion pour les fontaines et les jardins ; le noir aussi, qui symbolise à la fois la vie, le secret et le deuil, et qui est la seule couleur que l’artiste accepte de revêtir. Ces éléments fonctionnent à la fois comme des matériaux et des métaphores. Au sujet de l’eau de rose, omniprésente dans ses installations, Yosra Mojtahedi confesse : « On l’utilise un peu partout en Iran : on s’en sert pour cuisiner, pour se parer, pour séduire. Mais parfois, on peut aussi sentir cette odeur à la mosquée ou lors d’enterrement. Le parfum sent alors un peu différemment : il devient plus grave, plus impérieux ».

Le corps ausculté
L’air passe et s’échappe d’un respirateur artificiel, transite par un enchevêtrement de câbles immergés en partie dans la masse noire et visqueuse d’une flaque de moteur. Ailleurs, sur une stèle, un organe bizarre fait de pierre, de latex et de fourrure, s’active lascivement… Plus que de strictes anatomies, l’histoire de la statuaire est une histoire de corps fantasmé. Des canons de la sculpture grecque aux masses braves et paysannes du réalisme socialiste, chaque époque érige des statues dans lesquelles s’incarnent, par-delà les apparences, l’idée de ce qu’un corps devrait être. Les sculptures interactives de Yosra Mojtahedi portent elles aussi une certaine vision du corps, un projet politique : « À travers mes sculptures, j’explore l’humain dans toutes ses dimensions, qu’elles soient physiques ou culturelles : sociales, religieuses ou psychologiques. Mes recherches autour de la nature et de la place du corps humain – et plus particulièrement féminin – m’ont amené à m’interroger sur les différences qui existent entre les choses vivantes et inanimées. Je considère mes sculptures à la fois comme des corps, mais aussi comme des êtres ».
« À travers mes sculptures, j’explore l’humain dans toutes ses dimensions, qu’elles soient physiques ou culturelles : sociales, religieuses ou psychologiques. »
Ce que les œuvres de Yosra Mojtahedi incarnent, c’est ce moment particulier de l’histoire des corps qui ne se pensent plus exclusivement en termes d’humain ou de non-humain, mais dans lesquels les sangs, les chairs, les prothèses et les organes artificiels coexistent, s’infiltrent et s’augmentent mutuellement. Fascinée par les sciences, l’artiste iranienne, diplômée du Fresnoy- Studio national des arts contemporains, façonne et active ainsi des corps intermédiaires, inspirés à la fois des récits interspécistes de Donna Haraway et des écrits des poètes Rûmi et Hafez. Des chimères, au sens propre du terme, rendues possibles grâce à sa collaboration avec le laboratoire de Soft Robotics Inria Defrost, spécialisé dans la création d’organes artificiels mous et qui s’activent au sein des installations de l’artiste.

Interagir avec l’interdit
Chimérique, le travail de de Yosra Mojtahedi l’est à plusieurs égards. Au-delà des sculptures et des dessins, c’est l’ensemble de l’œuvre toute entière qui refuse de se plier à l’autorité de la stricte définition. Parce que la langue ne suffit pas, l’artiste réactive des langues mortes ou invente de nouveaux mots, capables de porter plusieurs sens à la fois. Différents espaces-temps mythologiques et prospectifs coexistent au sein d’installations belles comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie, mais dont on comprend difficilement ce qu’elles attendent de nous. L’Érosarbénus (2020) est à la fois une sculpture à regarder, une odeur à respirer et une complainte à entendre ; Sexus Fleurus (2021) doit être caressé, tandis que Volcanahita (2024) est à la fois un rituel et un paysage.
« Mon univers baigne dans une ambiance surréaliste, un espace libéré des contraintes du lieu et du temps où chaque objet revêt d’une charge symbolique ». Au-delà de sa richesse plastique, la force de l’œuvre de Yosra Mojtahedi réside en grande partie dans la singularité des expériences qu’elle provoque chez celles et ceux qui acceptent de s’y engager. Dans un essai intitulé Almost Nothing : Observations on precarious practices in contemporary art, Anna Dezeuze propose d’employer le terme « précaire » pour qualifier l’ensemble des œuvres qui n’existent qu’à la condition de l’attention qu’on leur accorde. L’historienne traite de ces œuvres en suspens, « presque imperceptibles », et qui menacent en permanence de disparaître si on refuse de les considérer.

À bien des égards, l’œuvre de Yosra Mojtahedi relève du précaire. Si les matériaux qui composent ses chimères résistent – au moins un peu – à l’exercice du temps, leurs cœurs battent au sein de la fragilité de l’espace relationnel mélancolique et bizarre qu’elles génèrent. Entrer dans l’œuvre de Yosra Mojtahedi, c’est renoncer au confort arbitraire des catégories bien définies pour se rendre compte que des choses que l’on croyait très opposées peuvent selon de nouvelles modalités paraître très proches. Tout y est intense à défaut d’être clair ; on interagit avec des choses oubliées, interdites ou à venir, et l’artiste nous accompagne pour ressentir les émotions incertaines que l’obscurité permet.
- Charnelles Interbioformae, dans le cadre de la Biennale Chroniques, jusqu’au 14.01, Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence.