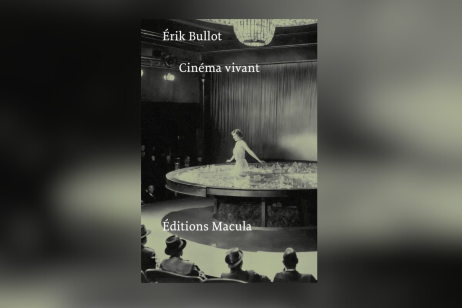Entre contes populaires et narration transmédiatique, Corentin Darré déploie son univers à la croisée des mythes et des formes virtuelles. À travers ses sculptures aux airs d’assets numériques et d’histoires où le queer réintègre l’hors-temps mythologique, l’artiste séduit autant par son esthétique singulière que par sa capacité à raconter.
On a beau les savoir factices, garder en tête qu’ils ont été façonnés de toute pièces et qu’il suffirait de faire quelques pas pour découvrir leurs coulisses et faire s’effondrer leurs illusions, les décors de théâtre, les attractions de fêtes foraines et les architectures vidéoludiques n’en reste pas moins de formidables outils narratifs, capables de transporter leurs visiteurs et de générer des émotions. Cela, Corentin Darré en a bien conscience, au point de mettre cette efficacité au service de ses propres histoires.
Diplômé de l’École nationale supérieurs des Arts de Paris-Cergy en 2020 et exposé au sein de plusieurs institutions prestigieuses (Palais de Tokyo, Lafayette Anticipations, Frac Île-de- France, où une façade monumentale de l’artiste vient d’intégrer les collections, etc.), Corentin Darré trace sa route sur la voie de l’art contemporain, semant sur son chemin des petites histoires aux airs de contes populaires et des sculptures à la plastique très virtuelle. Récemment exposé à la galerie sissi club à Marseille, l’artiste y présentait Chagrin, un solo show où les spectateurs étaient invités à découvrir l’histoire d’Henry et de Raphaël, deux amants maudits sous fond de westerns et de malédictions écocides. Rencontré dans le cadre de cette exposition, l’artiste a accepté de livrer cinq inspirations qui influencent aussi bien la teneur de ses récits que la manière dont il les façonne.

Les contes et les légendes populaires
« J’ai toujours été fasciné par les contes. Ils portent en eux une force intemporelle, mais ont aussi la capacité de s’adapter aux époques. Ils ont aussi un rôle étiologique, c’est-à-dire qu’ils expliquent l’origine des choses, des peurs et des injustices. En grandissant, je me suis rendu compte à quel point les récits dominants écrasent et marginalisent certaines identités. C’est à partir de là que j’ai voulu reprendre cette forme narrative : pour combler les vides et les silences, et offrir des histoires où le queer et l’altérité ont enfin leurs places. En réinvestissant ces récits, je peux changer de prisme, raconter l’histoire du point de vue du monstre, du marginal, et révéler ce qui a été effacé ou occulté.
La forme narrative me permet aussi de m’immiscer au sein de territoires et de leur folklore, en explorant les récits locaux ou les imaginaires propres à ces espaces. Cela offre une porte d’entrée familière aux visiteurs, la possibilité pour celles et ceux qui ne sont pas connaisseurs d’art contemporain d’entrer dans mes œuvres par le biais de ces références culturelles communes. »

Les personnages en marge et les monstres
« J’ai grandi à la campagne, sans figure de référence pour m’identifier en tant que jeune homosexuel. La première fois que j’ai vu deux hommes s’aimer dans un film, c’était dans Le Secret de Brokeback Mountain. J’aime profondément ce film, mais il m’a aussi mis face à un schéma au sein duquel le couple homosexuel ne peut être heureux qu’à la condition du secret. Dans un sens, je me sentais moi-même à la marge, en décalage avec mon environnement, sans modèle qui aurait pu m’aider à me projeter autrement.
Je me suis intéressé à ces deux figures archétypales – les marginaux et les monstres -, et à la façon dont ils évoluent au sein des récits. Souvent isolés, perçus comme des menaces ou des anomalies, ils partagent une origine commune dans la mesure où ils sont façonnés par le regard des autres, par une société qui projette sur eux ses peurs, ses normes et ses interdits. En travaillant à partir d’eux, j’ai compris à quel point ces figures racontent non seulement l’expulsion, mais aussi la manière dont cette exclusion peut être transformée en une forme de résistance. Mes monstres ne sont pas des méchants, mais des figures alternatives qui portent les stigmates de la violence normative et sociale. À travers eux, je cherche à explorer l’altérité comme une force, et non comme une condamnation. »

Les décors de cinéma et de théâtre
« J’ai récemment redécouvert Dogville de Lars von Trier, et ce film est devenu une référence visuelle centrale pour ma dernière exposition. Le décor se compose de quelques éléments et de quelques traits marqués au sol. Tout y est suggéré, rien n’y est montré directement et tout est fait pour pousser les spectateurs à s’imaginer ce qui manque. Je trouve cette expérience très proche de certains jeux vidéo, où les environnements sont fragmentés, épurés, et où chaque détail visuel a un rôle précis à jouer – c’est le cas de Journey ou Inside par exemple. Il n’y a rien d’inutile, rien de trop. Je m’inspire de ça dans mon travail. Les objets, les textures et les indices que je place fonctionnent comme les morceaux d’un puzzle. C’est aux spectateurs et aux spectatrices de s’impliquer, de recomposer mentalement et d’interpréter ce qu’ils voient. »

Les parcs d’attractions et les escape game
« Au moment où on franchit le seuil d’un parc d’attraction, on entre dans un univers totalement immersif, où tout a été pensé pour faire vivre une expérience. J’ai déjà travaillé dans un espace game, à la création des décors, et c’est là que j’ai compris l’importance de ces détails : tout doit servir à guider l’expérience, à intriguer et à maintenir le sentiment d’immersion. Dans mes installations, j’utilise des effets visuels, des textures, des éléments brillants pour attirer l’attention des visiteurs sur des détails spécifiques. La résine brillante, par exemple, ajoute à la fois une dimension tactile et une indication visuelle implicite : elle suggère qu’il y a quelque chose d’important à venir découvrir ici.
Ce que je recherche au fond, c’est créer une immersion physique au sein d’un récit. Non pas à travers l’usage de technologie, mais à partir d’éléments tangibles et sensoriels : la sculpture, le décor, l’image et le son. Je souhaite que les spectateurs ressentent une connexion directe avec l’espace et les éléments qui l’entourent. C’est au sein de cette interaction, entre le physique et l’imaginaire, entre ce que l’on perçoit et ce que l’on imagine, que réside la possibilité d’une immersion totale. »

La Pop Culture et la Culture Internet
« Ces cultures m’intéressent parce qu’elles fonctionnent comme des prismes à travers lesquels les phénomènes sociaux sont digérés, transformés et réinterprétés. J’aime leurs capacités à intégrer le chaos du monde et à le rendre accessible. C’est une manière d’appréhender les tensions de notre époque et de s’en saisir autrement. Aussi, j’aime intégrer directement des références populaires dans mes œuvres, comme pour contrebalancer la gravité des récits que je raconte. Certaines de mes installations empruntent leurs noms à des titres d’épisodes de Buffy, comme Never Kill a boy on the first date (2021) ou Once More with feeling (2020). I Wish you well in hell… (2023) fait référence à une punchline de Cardi B. Ces clins d’œil peuvent sembler anecdotiques, mais ils permettent d’ajouter une nuance à l’œuvre pour celles et ceux qui reconnaîtront la référence ou saisiront la blague. »