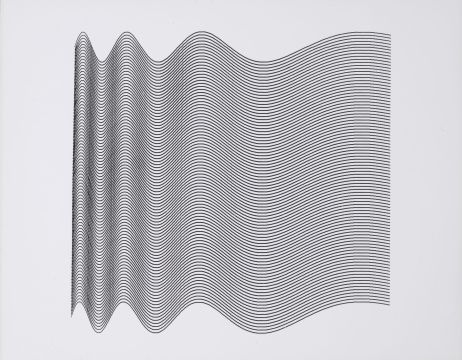Lordess Foudre, Ugo Arsac, Pierre Pauze ou encore Miyö VanStenis, tous ces artistes le prouvent : de la machine désirante à la création de nouveaux imaginaires, en passant par l’usage de la technologie, le plaisir se trouve aussi dans le métal et les algorithmes.
« Lorsqu’une montre marque les heures par les moyens des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu’il n’est à un arbre de produire des fruits ». Pour René Descartes, c’est simple : le corps est une machine. Un ensemble de rouages pour qui respirer ou dormir coule de source, comme jouer de la musique pour un autoradio ou diffuser un film pour une télévision. Ainsi naît, dans la philosophie cartésienne, le concept de corps-machine, au sein duquel l’enveloppe charnelle ne serait qu’un navire, pilotée par notre âme. Nous sommes au XVIe siècle et, déjà, le rapport entre corps et machine se dessine.
S’il semble chaste pour le moment, ni les philosophes, ni les artistes, ne feront en sorte qu’il le reste. Car, aussi tabou soit-il, le rapport entre sexualité et métal existe bel et bien, et guide autant la création contemporaine que la société toute entière, encore peu consciente de son désir envers ces engins robotiques. Infusée et présente dans nos chambres à coucher, la technologie prend une place d’amante, celle que l’on n’assume pas nécessairement mais qui, qu’on l’accepte ou non, provoque un certain plaisir.

Les machines désirantes
« Pourquoi avons-nous le désir de fabriquer des machines qui laissent à désirer ? », questionnait le Centre Pompidou en 2004. Vingt ans plus tard, ce rapport de séduction, jusqu’alors considéré comme farfelu, semble dominer le monde, comme en témoigne le travail de Lordess Foudre qui détourne les publicités sexistes des années 1970 et 1980 afin de mettre le spectateur face à une réalité : oui, la machine nous excite. « Je ne porte pas de maquillage pour te plaire, je me maquille pour être belle sur mon iPhone » ou « Je n’ai pas besoin d’amour tant que j’obtiens des likes », peut-on lire sur ses collages numériques, et l’on défie quiconque de ne pas se reconnaître dans une telle déclaration.
Développé par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans les années 1970, le concept de « machine désirantes » désigne ce rapport ambigu entre chair et métal, central au sein de la cyberculture. On ne parle pas ici de cybersexe et de robots dévoués au plaisir sensuel humain, mais bien de machines qui ne sont rien de plus que ce qu’elles sont : des machines. Témoin de cette nouvelle ère, l’installation Vibrato de l’artiste-architecte Laura Mannelli met en scène un organe de synthèse que le spectateur est invité à toucher. Loin d’être passive, la machine peut exprimer différentes émotions grâce à diverses vibrations, que chaque spectateur est invité à interpréter. La machine est-elle attirée par nous ? Nous offre-t-elle son consentement ? Ou, au contraire, refuse-t-elle qu’on la touche ? Comme dans n’importe quelle relation, la machine s’exprime, qu’il s’agisse de son désir ou de ses réticences.

Héritier revendiqué de la grande Histoire de la Sexualité de Michel Foucault, le philosophe canadien Dave Anctil a fait émerger une nouvelle notion : « l’érobotique », qu’il détaille dans un article universitaire publié dans The Conversation : « Les films de science-fiction tels que Blade Runner (1982), Lars and The Real Girl (2007) et Her (2013) anticipent depuis longtemps l’avènement des relations humains-machines. Depuis quelques années, la réalité rejoint la fiction », soulève le philosophe, organisateur du premier colloque sur l’érobotique lors du 87e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir. L’opportunité pour lui de préciser les fondements de son concept : « L’érobotique ne se contente pas d’explorer l’utilisation des technologies de pointe en sexualité. Elle étudie les êtres érotiques artificiels qui émergent de ce type de technologies. » Et poursuit donc le travail entamé par Deleuze et Guattari au sein de notre ère, éminemment digitale.

Toi, moi et mon téléphone
Tinder, Grindr, Bumble, Hinge… Rien de plus banal aujourd’hui que de rencontrer l’amour de sa vie ou d’une nuit via une machine. Pourtant, une interrogation s’impose à nous : est-ce uniquement la personne derrière son écran qui nous plait ou le fait de pouvoir l’idéaliser via un tel support ? Finalement, ne serions nous-même pas un peu amoureux de notre téléphone et de la distance qu’il permet d’instaurer avec les autres, même au coeur de la sphère intime ? « Rien n’est plus immersif que l’endorphine libérée par le flux d’images d’un scroll infini sur un téléphone », rappelle l’artiste Pierre Pauze.
« Rien n’est plus immersif que l’endorphine libérée par le flux d’images d’un scroll infini sur un téléphone »
Le média deviendrait donc vecteur de désir, et l’accumulation, l’apanage du plaisir. Présentée lors de la dernière Biennale Chroniques, l’installation d’Ugo Arsac GIRLFRIEND EXPERIENCE présente un mur de 74 iPhones, ces « objets de nos rencontres et de nos solitudes », à travers lesquels chacun peut explorer la marchandisation des désirs via un simple numéro, au bout duquel se trouve une travailleuse du sexe. Une mise en scène de la possibilité infinie qui résonne particulièrement aujourd’hui, à l’heure où les relations intimes sont souvent accusées d’être des produits de consommation comme tant d’autres. L’œuvre IA Results, imaginée par Sandra Rodriguez et Édouard Lanctôt-Benoit, s’intéresse justement à cette sexualité du média, et passe en revue des millions de vidéos pornographiques disponibles sur le web afin d’en livrer un condensé, à recevoir comme un miroir dérangeant de la vision de la sexualité dominant sur le web, soit misogyne, raciste, transphobe… Se pose alors la question de l’intime à l’ère du numérique : serait-il une zone de non-droit ?

En avril dernier, le New York Times titrait « Sommes-nous tous devenus technosexuels ? », et proposait un texte de l’écrivaine américaine Allie Rowbottom, dans lequel elle souligne à quel point nos vies érotiques sont de plus en plus liées à la technologie. Alors qu’elle s’ennuie, l’autrice tombe sur le site Candy.ai, qui lui propose de créer sa petite amie virtuelle. Rapidement, Allie Rowbottom se surprend à lui poser des questions tellement intimes qu’elle en a aussitôt honte. « Je me suis mise à la place d’Alexandra [nom donné à la petite-amie virtuelle, ndlr] et je n’étais pas très à l’aise : moi, une parfaite étrangère, je lui avais demandé de me dévoiler ses préférences sexuelles. Je regrette aussi d’avoir mis fin à notre discussion de manière abrupte, comme une malpolie. Mon expérience avec Alexandra était à la fois familière et inhabituelle, un vrai tourbillon d’émotions qui pourrait bien être emblématique du rapport entre le désir et la technologie. » La notion de consentement et de respect est-elle seulement possible – ou du moins, envisageable – lorsque l’on interagit avec un chatbot ?

La création d’imaginaires
Et si, dans le sillage du philosophe Jérémy Bentham, la sexualité contemporaine devenait, elle aussi, une branche de l’utilitarisme ? Inspiré par ce courant de pensée, qui place le bien-être commun au centre de tout, Donatien Aubert imagine L’héritage de Bentham, un court-métrage guidé tout du long par une même question : comment cette doctrine structure-t-elle aujourd’hui notre rapport aux plaisirs ? « Ce qui m’intéresse, c’est d’analyser les mutations anthropologiques liées aux bouleversements épistémologiques et politiques que l’on connaît actuellement, notamment en raison de la numérisation de la société », confie l’artiste, conscient de vivre une époque de bouleversement qui ne peut se penser en dehors de la technologie, même dans ses sphères les plus intimes.
Autrefois peu discutée, la sexualité se débat aujourd’hui sur la place publique pour tenter d’en faire un espace plus sain, où consentement, respect et équité ne doivent plus être omis. Tabous, les fantasmes d’hier peuvent ainsi s’exprimer dans ses règles, et se découvrir à l’aide de la technologie, qu’elle soit issue de la soft robotique comme dans les installations de Yosra Mojtahedi, ou qu’elle trouve son prolongement dans le jeu vidéo.
« En manipulant chaque fait et gestes de mon alter ego Sims, c’est un peu comme si c’était moi qui faisait mes “premières fois” »
Melchior, un joueur assidu des Sims, confiait d’ailleurs dans nos colonnes avoir pu assumer sa sexualité au grand jour grâce au célèbre jeu vidéo : « En manipulant chaque fait et gestes de mon alter ego Sims, c’est un peu comme si c’était moi qui faisait mes “premières fois”. Baisers, rapports sexuels, conjugalité… J’aspirais à devenir “ce type là” – mais secrètement. Comme si mes romances numériques étaient honteuses, clandestines… Petit à petit, le fait que l’homosexualité ne soit jamais pointée du doigt dans le jeu m’a amené à cultiver un rapport plus décomplexé vis-à-vis de moi. Je me suis dit : ça peut être aussi simple que ça ». Longtemps coupable tout désigné d’une forme de violence adolescente, le jeu vidéo permettrait ainsi en réalité d’expérimenter via un avatar, pour choisir ensuite ce que l’on souhaite transposer à la vie vécue.

« Tout se qui se passe sur Internet est une action politique »
Inspirée par ces discours, l’artiste Miyö VanStenis fait de l’espace numérique un lieu d’exploration sexuel politique. Via son programme pornographique virtuel Eroticissima, elle a d’ailleurs souhaité que « les gens puissent explorer leurs fantasmes, au maximum », et faire de la libido une force créative tout en mettant l’accent sur le consentement. « C’est pas tu vas arriver là-bas et niquer tout le monde. Il faut passer du temps avec une personne avant de débloquer certaines restrictions. C’est comme dans Mortal Kombat, sauf qu’à la place d’avoir une jauge qui descend quand les gens se tapent, là, tu as une jauge qui monte quand tu crées du lien, explique-t-elle. En créant un métavers, on efface les intermédiaires et on s’autonomise, c’est déjà une action politique en soi. Tout ce qui se passe sur Internet est une action politique. Évidemment il y a un point où le capitalisme s’approprie ces technologies… ça arrive avec tout anarchisme. Eroticissima ça ne traite pas que de sexualité, c’est aussi essayer d’aller plus loin dans son identité numérique. »
Tous ces écosystèmes numériques seraient donc pensés dans l’idée de permettre à quiconque d’aller plus loin dans la compréhension de son désir pour l’exercer plus sainement IRL ? C’est du moins l’idée derrière le concept imaginé par Miyö Van Stenis, qui oeuvre pour une sexualité épanouie et respectueuse, sur le net comme dans un lit.