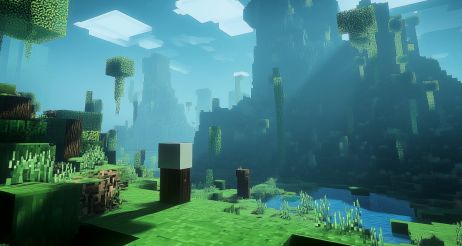Voilà treize ans que Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner et Michael Stumpf arpentent les tranchées pixelisées des champs de batailles numériques ainsi que les faubourgs virtuels des AAA afin de révéler les idéologies que le jeu vidéo charrie. Depuis son appartement de Vienne, Leonhard Müllner a accepté de revenir en détail sur le mode opératoire et la division du travail pratiqués par Total Refusal.
« Si vous voulez comprendre une société, regardez attentivement ses médias de masse » conseillait Marshall McLuhan. Avec 3 milliards de joueurs en 2024, le jeu vidéo n’est plus seulement un divertissement : il devient, pour Total Refusal, un terrain d’étude et une zone d’opération à investir pour dénoncer les dérives du néolibéralisme algorithmique.
Sur son site internet, le collectif se présente ainsi comme « une guérilla médiatique pseudo-marxiste focalisée sur l’intervention et l’appropriation de jeux vidéo mainstream ». Héritier·es de pratiques d’appropriation artistiques des années 1960/1970 et des cultural studies, les quatre Autrichien·nes opèrent à la manière d’ethnographes qui auraient troqué le terrain anthropologique en faveur des univers virtuels. « Nous nous concentrons sur les jeux grand public, qui constituent des lieux de fantasme, mais aussi d’anxiété contemporaine, où le sujet néolibéral peut réaliser les promesses non tenues du capitalisme ». Et comme tout anthropologue qui sait qu’une société se révèle moins à travers ses lois officielles que par l’examen des mécaniques invisibles, Total Refusal s’intéresse aux mécaniques et aux sous-textes imperceptibles qui encouragent ou normalisent certains comportements. « Les jeux vidéo et le capitalisme partagent un point commun : celui de faire croire aux individus qu’ils souhaitent véritablement ce qu’on les pousse à désirer ».

Une ethnographie des mondes virtuels
Le plus souvent, le collectif opère à partir de similitudes frappantes entre mécanique vidéoludique et injonctions normatives : La gamification de la violence, la promotion à peine masquée des armes à feu ou l’injonction à l’hyper-compétitivité via les formules Battle Royale type Fortnite ou Apex Legends composent autant d’objets d’études privilégiés pour celles et ceux qui se présentent aussi comme « un groupe de désarmement numérique ». Véritable essai in-game, How to disappear constitue un bon exemple du travail du collectif. Réalisée en 2019, la machinima se présente sous la forme d’un film anti-guerre tourné directement dans les moteurs de Battlefield V, pour explorer les possibilités réelles et virtuelles de résistances pacifiques et de désertion dans un contexte belliqueux où les déserteurs ont souvent été pointées du doigt comme traites à la notion.
Battlefield V est un cas intéressant, affirme Leonhard Müllner : « C’est un jeu dont toutes les mécaniques vous obligent à « jouer à la guerre », sans véritable possibilité de désertion ou de résistance pacifique. En même temps, le jeu se dédouane de toute responsabilité politique. Dans certains niveaux, vous incarnez un tireur d’élite de l’armée royale britannique et dans un autre un officier de la Wehrmacht sans que cela ne présente la moindre conséquence ».

Ce que le capitalisme a fait au jeu vidéo
Dans La société de consommation (1970), le philosophe Jean Baudrillard développe l’idée selon laquelle – dans la société moderne – le loisir ne constitue plus un véritable temps libre, mais plutôt une extension de la logique capitaliste et productiviste qui gouverne déjà le temps de travail. Le jeu vidéo ne semble pas avoir échappé à la vague de fond. Culture du crunch, système pay-to-win, extraction incessante de ressources… Pour Leonhard, c’est évident : le jeu vidéo contemporain a beau être turbulent, il n’en reste pas moins l’enfant très légitime du capitalisme tardif.
« Les jeux vidéo et le capitalisme partagent un point commun : celui de faire croire aux individus qu’ils souhaitent véritablement ce qu’on les pousse à désirer. »
Joueur·euses passionné·es, les membres de Total Refusal déplorent une dérive néolibérale qui colonise jusqu’à l’espace du loisir en s’appuyant, selon Leonhard, sur le même discours méritocratique pour justifier l’investissement économique et temporel qu’il exige de la part de ses adeptes. « Le grind (qui désigne la pratique répétitive de tâches monotones et fastidieuses permettant de progresser dans le jeu, ndr) est devenu la norme. Des missions répétitives, générées par IA, qu’il faut accomplir pour rester compétitifs. L’optimisation statistique de tous les pans du jeu est un autre symptôme de cette corruption. Du bouclier aux chaussures, chaque item de votre tenue a des stats qu’il faut passer son temps à comparer en retournant dans son inventaire. Parfois, j’ai l’impression d’être le comptable de mon avatar ».
Le collectif n’est pas le seul à faire ce constat. Sur les forums, d’ancien·nes joueur·euses professionnel·les de World of Warcraft témoignent de semaines de 70 à 98 heures de jeu pour maintenir leur niveau compétitif. En résulte une fatigue physique et émotionnelle en tout point comparable à celle d’un burn-out. « Si vous restez dans ces jeux, ce n’est pas parce qu’ils sont amusants. Ils vous maintiennent, vous stressent pour que vous y restiez parce qu’avant d’être des jeux, ce sont avant tout des mondes sociaux », analyse Leonhard.

Ce que le jeu vidéo fait au monde
En tant que média de masse, le jeu vidéo ne se contente pas de témoigner du réel, il participe aussi activement à sa production. Rappelez-vous : nous sommes le 06 janvier 2021 et le monde assiste, consterné, à la prise du Capitole par les troupes de partisans du président sortant Donald Trump. Casquette MAGA ou coiffe à plume sur la tête, une foule bigarrée et lourdement armée d’Oath Keepers, de Proud Boys, de Three Percenters et d’autres Boogaloo foule, batte de baseball ou drapeau confédéré à la main, le damier de marbre du sol de la chambre du Sénat. Aussi surréaliste que soit la scène, cette cohorte semble pourtant familière à Susanna, Robin, Leonhard et Michael. Deux ans plus tôt, Ubisoft avait imaginé cette même scène : des paramilitaires investissant le Capitole dans The Division II (2019), sur lequel le collectif est justement en train de travailler.
« Avant d’être des jeux, ce sont avant tout des mondes sociaux. »
« Nous avons profondément été interpellés par les similitudes qui existent entre la milice virtuelle des « True Sons » et les membres des groupes crypto-fascistes paramilitaires qui ont pris d’assaut le Capitole. C’était dingue de voir à quel point ils se ressemblaient. À partir de cela, nous avons cherché à étudier les liens qui existent entre la communauté gaming et les courants de pensée réactionnaires et ultra-masculinisés qui ont permis la réélection de Trump, et notamment l’engagement de son ancien conseiller politique, Steve Bannon, auprès des joueurs masculins. » Dans la performance in game Sons and True Sons (2025), le collectif rejoue dans l’univers d’Ubisoft la prise d’assaut du Capitole. Avec les communautés en ligne, iels discutent de la portée politique des jeux, de la violence inhérente au médium, et du rapport entre les communautés en ligne et les discours ultra-réactionnaires qui se développent sur certaines plateformes.

« L’anti-féminisme et les violences sexistes sont sûrement les domaines les plus violents à discuter du médium. Dans les communautés en ligne, comme dans le monde réel, le discours quant au rôle des hommes et des femmes rétropédale complètement, conclut Leonhard, sûr de ses forces. En tant que marxistes, nous souhaitons que le monde devienne beaucoup plus critique quant à l’analyse de son environnement médiatique et des idées qu’il véhicule. C’est la raison d’être de notre collectif. Nous nous devons de subvertir ces médias de masse avec leurs propres outils ».