Plus un contenu obtient de clics, plus il est recommandé par les algorithmes. Si bien qu’il n’est guère difficile aujourd’hui d’obtenir de la reconnaissance en ligne en s’achetant des bots artificiels. Dans sa dernière série, Beggar’s Honey, le photographe Jack Latham a rencontré ceux qui les produisent, dans des fermes à clics, situées à l’autre bout du globe, dont l’impact sur nos sociétés est pourtant de moins en moins virtuel.
En juin 2024, en pleine campagne pour les législatives, Jordan Bardella, explose son nombre de vues sur TikTok : des extraits vidéos où il est filmé mangeant un hot-dog ou un verre de blanc à la main apparaissent en top trend. Depuis, certains spécialistes soupçonnent le président du rassemblement national d’avoir utilisé des bots pour gonfler ses likes, et ainsi gagner en visibilité sur le web. Pour les politiques comme pour les influenceurs, la présence sur réseaux sociaux est devenue le nerf de la guerre. C’est le constat qu’a fait Jack Latham en 2020, alors que le Brexit s’accompagnait d’une manne de fake news et autres intox. Dans ce contexte, le photographe britannique décide d’investir les coulisses du clic, à plusieurs milliers de kilomètres de là, où prolifèrent les click-farms, ces immenses bureaux où l’on propose des vues à la pelle, des likes en masse, et des armadas de followers fantômes : « Il y en a beaucoup dans les pays communistes d’Asie parce que le prix de l’électricité y est bien moins cher et plus stable qu’en Europe », observe celui qui a discuté de longs mois avec des propriétaires d’usine à clics avant de se rendre sur place.
En tout, Jack Latham en a visité sept, situées entre Hong-Kong et le Vietnam, nichées dans des chambres d’hôtels reconvertis en centres informatiques ou dans des bâtiments de plusieurs étages, chacune ayant sa spécialité : TikTok, YouTube, Instagram ou Facebook. C’est dans cette zone grise de nos sociétés que se déroule l’investigation du documentariste, là où l’on peut s’acheter une réputation pour quelques milliers d’euros, là où ce business attire toujours plus de jeunes entrepreneurs asiatiques tirant profit de cette course à la visibilité.

Habituellement, vous faites beaucoup de portraits. Dans la série Beggar’s Honey, il y en a finalement très peu. Était-ce par soucis d’anonymat ou par choix artistique ?
Jack Latham : Les deux. Les fermes à clics appartiennent à cette zone floue de la loi, dans le sens où il est difficile de dire si elles sont légales ou non. La seule chose qui est sûre, c’est qu’elles vont à l’encontre des termes et conditions des réseaux sociaux, c’est pourquoi elles veulent rester très discrètes. Je ne voulais pas les compromette, ce n’est pas mon boulot, je ne suis pas un lanceur d’alerte mais un photographe d’art. Vous seriez surpris du nombre de personnes désireuses de s’acheter des followers qui m’ont demandé de les mettre en contact avec ces fermes à la suite de cette série. Il y a même un organe de presse russe qui a réussi à trouver une des fermes à clics que j’ai visitées. La seule personne photographiée est prise de dos. Le reste, ce sont des écrans ou des immeubles qui abritent des fermes à clics. C’était une façon pour moi d’exprimer le caractère impersonnel des interactions sur les réseaux sociaux.

Effectivement, vos photos montrent un univers très froid. Il y a une image récurrente, montrant des téléphones suspendus les uns à côté des autres. À quoi cette étape correspond-elle dans la chaîne d’une usine à clics ?
JL : C’est ainsi qu’une ferme à clics se compose : des centaines et des centaines de téléphones alignés. Avant de pouvoir programmer les téléphones, les « clicks farmers » cliquaient manuellement sur chaque téléphone. Aujourd’hui, le processus a changé : il n’y a plus d’écran, les téléphones sont directement branchés à des ordinateurs qui déclenchent les clics automatiquement. Une des fermes les plus impressionnantes que j’ai visitée occupait trois étages d’un immeuble. À l’intérieur, ils étaient huit employés, avec un système de rotations, et ils contrôlaient quelque chose comme 30 000 ou 40 000 téléphones portables.
« La plupart du temps, ces fermes ne savent pas qui sont leurs clients, ni quelles sont leurs intentions. Ils font ce qu’on leur dit de faire. »
Vous avez pu discuter avec ces employés ?
JL : Oui, bien sûr, il y en a certains à qui je parle encore. Ils sont assez jeunes, ils gagnent bien leur vie, la société les accepte plutôt bien. Au Vietnam, c’est comme travailler dans une start-up tech. Ce sont des gens très sympathiques, ils n’ont pas à avoir honte. Ce n’est pas eux le problème, mais les gens qui leur passent commande. La plupart du temps, ces fermes ne savent pas qui sont leurs clients, ni quelles sont leurs intentions. Ils font ce qu’on leur dit de faire.

En France, on soupçonne le succès phénoménal de Jordan Bardella sur TikTok d’être lié à l’usage de bots pour faire grimper l’algorithme en sa faveur. En fin de compte, ces fermes à clics ont des incidences bien réelles sur nos sociétés…
JL : Vous savez, je suis en Angleterre en ce moment, le pays est secoué par une vague d’émeutes. Tout ça a commencé parce que quelqu’un a lancé une fausse rumeur dans un tweet. Ce tweet s’est ensuite propagé et puis, les gens s’en sont pris aux musulmans ; alors même que la personne qui a commis les agressions au couteau n’était pas musulmane. Quand une personne a un grand nombre de followers, les gens ont tendance à lui accorder plus de confiance : ce qui devient très dangereux lorsqu’il s’agit d’une personne comme Tommy Robinson, qui a sciemment diffusé de fausses informations (Tommy Robinson est le fondateur de l’EDL – English Defence League -, groupe xénophobe et raciste qui a alimenté les attaques contre les dernières émeutes, ndlr).
Une étude montre que la désinformation se propage quatre fois plus vite que la vraie information, car elle est souvent choquante. Elle suscite une réaction, que ce soit de la colère ou autre. Les gens sont donc plus susceptibles d’interagir avec une chose pour laquelle ils ressentent de vives émotions. Si les personnes de droite ont tendance à être meilleures sur les réseaux sociaux c’est sans doute dû à cela. Je suis toujours frustré lorsque les gens de gauche interagissent avec du contenu de droite car en interagissant ils le rendent plus populaire. C’est une sorte de spirale : Ce que vous détestez prend plus d’importance parce que vous le détestez.
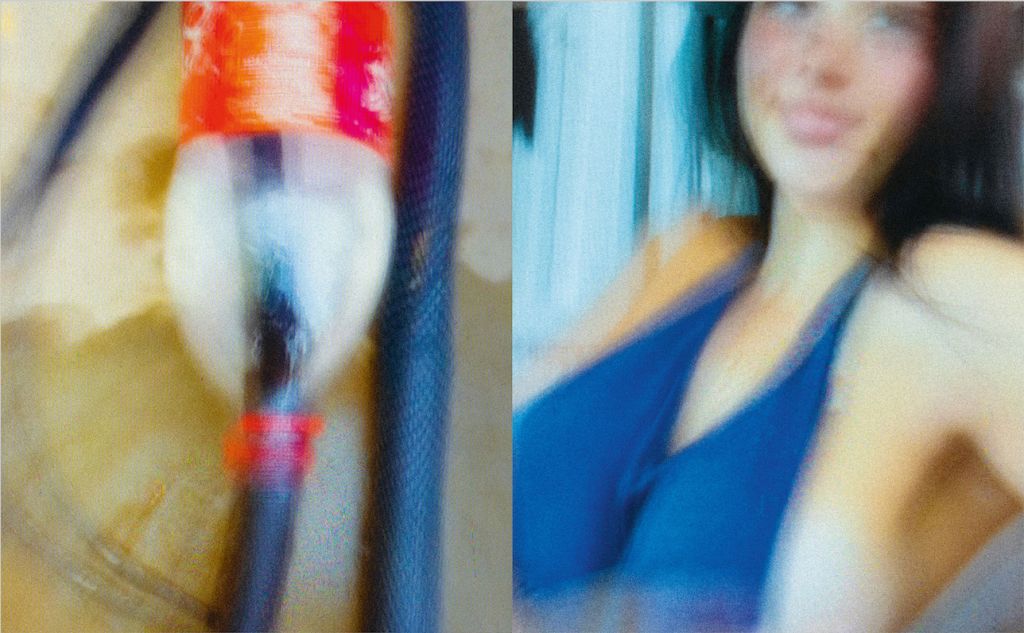
Entre deux images d’iPhone, il y a cette fille en maillot de bain, avec un titre provocateur : « Veux-tu voir ma chatte ? » Que fait-elle ici, dans cette série où l’humain est absent ?
JL : J’ai fait une expérience, chez moi, en créant une mini-ferme à clics, à mon échelle. Je jonglais avec une vingtaine de téléphones. J’ai installé mon appareil photo devant les écrans, et je photographiais dès qu’un nouveau contenu apparaissait dessus. C’était un flux d’images sans rapport entre elles. Comme dans les usines à clics, je ne savais pas qui me demandait d’interagir. Un tsunami, un champignon nucléaire, les Twin Tower, une fille hypersexualisée… le seul point commun, c’est que c’était toujours du contenu conçu pour rendre les gens à la fois accro et engagé. J’ai entendu dire sur la BBC que l’État Islamique utilisait beaucoup TikTok : ça commence avec la vidéo d’un chien mignon pour vous appâter, puis, plus vous swipez, plus vous allez être redirigé vers du contenu de propagande. Finalement, l’algorithme est manipulé pour devenir un outil de recrutement. Beaucoup de personnes mal intentionnées essaient de manipuler ces algorithmes pour diffuser leur idéologie.
« Une étude montre que la désinformation se propage quatre fois plus vite que la vraie information, car elle est souvent choquante. »
Vos projets artistiques sont souvent liés à des légendes souterraines. Est-ce le rapport à l’interdit qui motive votre travail ?
JL : C’est plutôt le rapport au non-dit. Mon premier grand projet était Sugar Paper Theories, qui s’est déroulé en Islande où six personnes ont été manipulées par la police pour signer des aveux à propos d’un meurtre qu’elles n’avaient pas commis. Avec Parliament of Owls, j’enquêtais sur le Bohemian Grove, un club privé réunissant des personnalités influentes dans une forêt. Les gens inventaient des histoires de conspiration folles autour de ce lieu auquel ils n’avaient pas accès. Avec cette dernière œuvre, Beggar’s Honey, je m’intéresse moins aux théories du complot qu’à la manière dont elles circulent sur Internet. Toutes mes œuvres traitent de la même chose : la manière dont on communique la vérité dans nos sociétés.
- La série Beggar’s Honey sera exposée du 07 au 29 septembre à la Biennale Images Vevey, en Suisse.











