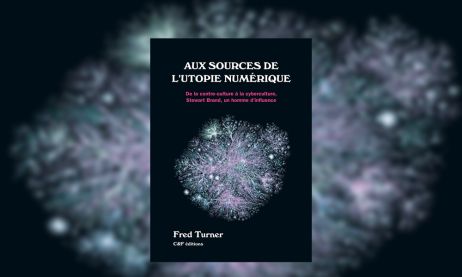D’un côté, il y a cette réalité : 90% des projets développés au sein de la Silicon Valley sont mis sur la touche, faute d’utilisateurs. De l’autre, des entreprises comme Google, Meta ou Apple, qui revendiquent 2 milliards d’appareils actifs et ont injecté près de 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement. Au milieu, une course à l’innovation constante, qui a des répercussions jusque dans le monde de l’art. Le champ artistique a-t-il été abandonné aux utopies des grandes firmes technologiques ? Discutable. Discutons.
L’histoire commence comme dans tant de films hollywoodiens, par un périple en direction de l’Ouest américain, vers une destination lointaine, en quête d’un eldorado : la Californie, une contrée où le soleil donne et où la vie peut se transformer en or, voire se connecter de manière concrète au devenir-machine de l’être humain. Ce voyage, c’est celui effectué par l’auteur Alain Damasio pour son dernier ouvrage, Vallée du silicium, au sein duquel il arpente le « centre du monde » (traduction : San Francisco, et plus précisément encore la Silicon Valley) dans l’idée de mettre à l’épreuve sa pensée technocritique, de se laisser traverser par un réel qui le bouleverse. « Ce qui manque furieusement à notre époque, c’est un art de vivre avec les technologies, écrit-il en préambule. Une faculté d’accueil et de filtre, d’empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Des pratiques qui nous ouvrent le monde chaque fois que l’addiction rôde, un rythme d’utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l’attention qui nous décadre et une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise. »
Pour les besoins de Vallée du silicium, Alain Damasio a rencontré de nombreux chercheurs, sociologues et techies travaillant pour Apple, Meta, Google ou encore Netflix. Il en ressort 208 pages au sein desquelles l’auteur interroge tour à tour la prolifération des IA, l’art de coder, l’avenir de nos corps (à l’entendre, la réappropriation du corps, si présente au sein de l’art numérique, voire même de nos sociétés, serait le symptôme de ces technologies qui nous en éloignent quotidiennement) et les métavers. On y croise ainsi des voitures autonomes devenues incontrôlables, des humains obsédés par le contrôle de leur santé ou des programmeurs dépeints en artistes des temps modernes. Sans jamais verser dans la technophobie, Damasio tend à prouver que la Silicon Valley n’est définitivement pas un lieu, mais davantage un état d’esprit, qu’être un écrivain de science-fiction en 2024 revient finalement à être un écrivain réaliste. « On est dans un monde repensé par la Sillicon Valley », confie-t-il dans un entretien à France Inter.

De la création à la rentabilité
C’est que ce territoire aux paysages sans reliefs, où les SDF tentent de survire à proximité directe des ultra-riches dans des quartiers tels que Tenderloin (où se trouve le siège social de X, ex-Twitter), exerce à l’évidence une forte influence. Sur nos vies, sur nos comportements, mais aussi sur l’art, même en arrière-plan. Depuis 2011, par exemple, on ne compte plus le nombre de projets d’art numérique financés par Google via sa plateforme « Arts & Culture ». Dernier exemple en date ? XENON PALACE CHAMPIONSHIP de Sara Sadik, une vidéo interactive, finalement proche du jeu vidéo, dans laquelle l’artiste française filme une bande d’hommes fuyant l’ennui en entraînant des Xenons, des créatures fantastiques émergeant des volutes de fumées d’un bar à chicha.
L’idée, évidemment, n’est pas de pointer du doigt de telles collaborations, par ailleurs passionnantes, ni même de critiquer l’existence de telles créations, singulières, qui exploitent les nouvelles technologies et ne seraient sans doute pas envisageables sans de tels soutiens financiers. L’idée est plutôt de comprendre quel art cela façonne ? Qu’est-ce que ça signifie pour Google d’injecter près de 32 milliards de dollars dans la recherche et le développement ou pour Meta de lancer son premier casque de réalité augmentée ? Tous ces investissements sont-ils réellement fait au nom de l’art, ou simplement dans l’idée de rester compétitif au sein d’un monde tourné vers l’innovation constante ? Si nos vies sont bel et bien façonnées par les ingénieurs de la Silicon Valley – soit une population majoritairement blanche, touchant en moyenne entre 10 000 et 15 000 dollars par mois -, qu’en est-il de l’art ?

La fin du mythe ?
Si l’objectif de toute start-up, surtout à San Francisco, est de proposer des outils révolutionnaires à même de changer le monde, à l’image de Kin.art, une plateforme visant à protéger les œuvres d’art contre la contrefaçon numérique et autres vols de créations par les systèmes d’IA, d’autres préfèrent s’écarter de cette utopie technologique. Après avoir longtemps travaillé en tant qu’ingénieur-programmeur chez Next, une société créée par Steve Jobs, Antoine Schmitt s’est lancé au cours des années 2000 dans une création artistique qui s’appuie sur la technologie sans chercher à pousser cette dernière dans ses retranchements, sans nourrir envers elle une quelconque fascination. Même constat pour Gretchen Andrew, employée chez Google entre 2010 et 2012, avant de tout laisser tomber pour se consacrer à la peinture et à l’exploration de la réalité virtuelle. « J’étais contrariée par ce qui m’arrivait personnellement dans la Silicon Valley, mais je croyais encore au potentiel de ces outils et de ces systèmes qu’il est possible d’utiliser d’une manière que Google n’avait pas prévue », confiait-elle au média Fast Company.
À défaut d’être réellement indépendant de toutes ces technologies, voire même de pouvoir les recycler, les bidouiller ou s’en détourner, il est toutefois permis, grâce à l’art, de les hacker et d’acquérir une certaine forme d’autonomie et de liberté. Ce qui n’empêche pas la Silicon Valley d’imprégner durablement l’imaginaire des artistes : tandis que Zach Blas, via les images animées de CULTUS, envisage les grands patrons d’Apple ou Google comme les prophètes d’un Dieu tout puissant nommé « IA », Simon Denny réalise des peintures numériques au nom équivoque (Metaverse Landscape), présentées dans ses expositions aux côtés de sculptures réalisées à l’aide de tableaux blancs vendus par X (ex-Twitter).
Quant à Adelin Schweitzer, du collectif deletere, il confesse se servir des innovations en cours dans l’Ouest américain pour mieux s’en écarter : « Il y a dans l’idéologie californienne et celles incarnées par les grands pontes de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg, la volonté de nous faire croire que le progrès passe par la technologie… Qu’elle nous permet de relever tous les défis de notre temps. De nous faire admettre qu’elle est utilisée pour créer du “vivre ensemble”. Or je pense qu’elle produit exactement l’inverse. »

Une société imaginaire
On en revient alors ce que questionne Alain Damasio dans Vallée du silicium : dans un monde reconfiguré par la Silicon Valley, comment s’affranchir de ses dogmes plutôt que de se contenter d’errer dans un imaginaire qu’elle a elle-même quadrillé ? Est-on vraiment autonome lorsque l’on est à ce point relié à un monde factice qui grignote peu à peu le réel ? Quid de l’art, devenu selon le sociologue américain Fred Turner, avec qui Damasio s’est rendu au sein de l’Apple Park, « une sorte de monnaie mondiale » ?
Si Gretchen Andrew continue de voir en l’art un lieu où l’on défend l’individualité et la perspective – en opposition aux valeurs de la Silicon Valley, tournée vers une supposée universalité -, le mot de la fin revient à Kasia Molga. Rencontrée en juin 2023, l’artiste anglaise encourage en effet les artistes, via son installation Positively Charged, à façonner leurs œuvres sans dépendre des géants de la tech. « Je pense qu’il est important de revenir aux questionnements essentiels : qu’est-ce qu’une œuvre simple et accessible ? Comment le public se projette-t-il, comment s’approprie-t-il une œuvre ? Je ne voulais pas beaucoup de composants électriques dans Positively Charged, simplement du public participant pour l’animer ». À l’opposée, en somme, d’une industrie et de ses mastodontes lancés dans la course du capitalisme de rente.